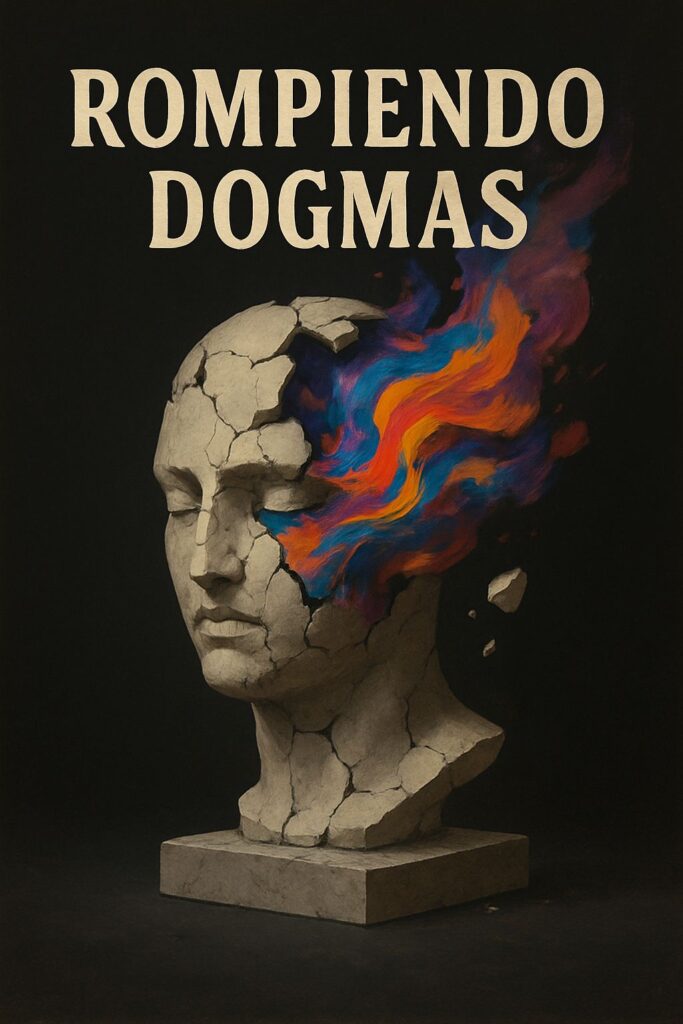FRENCH TEXT
BRISER LES DOGMES
Le monde est rempli de certitudes que nous acceptons automatiquement. Dès l’enfance, nous apprenons que certaines émotions doivent s’exprimer de manière spécifique, que certaines idées représentent « la vérité absolue » ou que les enseignements de notre jeunesse doivent rester inchangés.
Cette adhésion rigide à des croyances que nous refusons d’examiner donne naissance à ce qu’on appelle le dogmatisme.
Bien que nous associons souvent le dogme à la religion, son influence s’étend à d’autres domaines : idéologies politiques, systèmes éducatifs, méthodes scientifiques et même nos relations personnelles.
Nous reconnaissons le dogme lorsqu’une idée devient si sacrée que la remettre en question est perçu comme une offense ou une trahison.
Le dogmatisme transforme des opinions, des théories ou des croyances en vérités absolues qui ne tolèrent aucun débat. C’est comme ériger des murs autour de nos idées, les protégeant de toute critique. Ces forteresses mentales nous rassurent, mais elles nous emprisonnent aussi.
Le regard sceptique
Dès la Grèce antique, les sceptiques ont observé une tendance à s’accrocher à des certitudes indémontrables. Les pyrrhoniens qualifiaient ces croyants de « dogmatiques ».
En étudiant les doctrines de son époque, Sextus Empiricus, principal représentant de cette école, a documenté une inclination presque inévitable à rechercher la certitude, même en l’absence de preuves solides.
Au XXᵉ siècle, le philosophe Willard Van Orman Quine a remis en question, dans son essai Deux dogmes de l’empirisme, la distinction supposée entre vérités analytiques (certaines par définition) et vérités synthétiques (fondées sur l’expérience). Il a montré que cette division s’efface lorsqu’on examine comment le langage et la connaissance fonctionnent réellement.
Cette réflexion ébranle les fondements intangibles de la science. Même dans le domaine scientifique, le dogmatisme peut surgir lorsque des postulats de base sont défendus comme des vérités indiscutables, écartant l’esprit critique pourtant essentiel à la quête de savoir.
Notre connaissance s’organise en un système de croyances interconnectées qui ne touchent à l’expérience qu’en leurs bords extérieurs. Lorsque la réalité contredit une partie de ce système, nous avons plusieurs options pour l’ajuster—et souvent, nous choisissons de préserver les croyances les plus ancrées, en modifiant seulement celles qui sont plus périphériques.
Le dogmatisme scientifique, par exemple, protège le noyau théorique en créant des hypothèses auxiliaires toujours plus complexes pour expliquer les anomalies. Les programmes de recherche peuvent devenir « dégénératifs » lorsqu’ils sombrent dans cette spirale d’auto-préservation dogmatique.
Le dogme social
Au Moyen Âge, le dogme religieux servait à la fois de lien social et de protection du pouvoir établi. Les credos chrétiens dictaient avec une autorité absolue ce que les croyants devaient accepter. Toute tentative de reconsidérer ces vérités pouvait être qualifiée d’hérésie—avec des conséquences souvent tragiques.
Cette posture garantissait que la communauté reste unie autour d’une seule version officielle de la foi. Le dogme offrait ainsi une « garantie du cœur »—la certitude réconfortante de partager des vérités immuables avec les autres.
Lorsque tout le monde croit aux mêmes certitudes, on éprouve un sentiment d’appartenance et de but commun. C’est pourquoi les sociétés ont historiquement développé des systèmes pour transmettre et protéger leurs dogmes centraux.
Les religions—et par extension, d’autres systèmes dogmatiques—favorisent une solidarité mécanique, une unité basée sur l’uniformité de pensée. Ce lien crée de la stabilité, mais aussi une résistance au changement et une hostilité envers ceux qui contestent les vérités établies.
L’anthropologie de la certitude
Les êtres humains ont besoin de cadres stables pour donner un sens au chaos de l’existence. Nous cherchons des schémas, des explications et des prédictions pour ordonner notre monde.
Les sociétés traditionnelles élaborent des systèmes classificatoires complexes, séparant le « pur » de l’« impur », l’« ordonné » du « chaotique ». Souvent renforcés par des tabous et des rituels, ces systèmes atténuent l’anxiété face à l’ambiguïté. Sous cet angle, le dogmatisme peut être vu comme une défense contre l’angoisse de l’incertitude.
Les dogmes modernes
Dans la société actuelle, les dogmes persistent sous des formes que nous ne reconnaissons pas toujours.
Un exemple est le dogme de la méritocratie—la croyance que la réussite dépend uniquement de l’effort individuel. Pris comme une évidence, ce postulat ignore les structures sociales qui avantagent certains et en défavorisent d’autres. Ceux qui ne « réussissent » pas sont accusés de « ne pas assez travailler », tandis que les privilèges systémiques des plus favorisés restent invisibles.
Parmi les autres dogmes contemporains :
-
La croyance en une croissance économique infinie comme seul indicateur de progrès.
-
L’idée que la technologie résoudra tous nos problèmes.
-
La conviction que la consommation est la voie principale vers l’épanouissement.
Ces récits fonctionnent comme des credos séculiers, rarement remis en question dans le discours dominant.
Un autre dogme répandu est celui du bonheur comme responsabilité individuelle. Selon cette croyance, chacun doit « travailler sur soi » pour être heureux, quelles que soient les circonstances extérieures. Promu par l’industrie du développement personnel et certaines approches psychologiques, ce dogme transforme le malaise social en un problème d’attitude personnelle. L’incapacité à être heureux devient un échec moral—et non un symptôme de problèmes structurels.
Le dogmatisme épistémologique
Une doctrine appelée dogmatisme épistémologique soutient que si quelque chose nous paraît évident et qu’il n’y a pas de raison d’en douter, nous avons le droit d’y croire. L’objectif est de justifier des croyances fondamentales sans preuve—mais cela mène au paradoxe du dogmatisme : comment rejeter des preuves qui contredisent ce que nous tenons pour certain ?
Une issue possible se trouve dans le faillibilisme, développé par Charles S. Peirce. Selon cette perspective, nous pouvons maintenir nos croyances tant qu’elles ne sont pas réfutées—à condition d’être prêts à les réviser face à de nouvelles données. Ainsi, la connaissance repose sur une confiance raisonnable, associée à une volonté permanente de corriger les erreurs.
Nous avons naturellement tendance au biais de confirmation : nous accordons plus de poids aux informations qui confirment nos convictions. La psychologie cognitive a étudié ce phénomène, révélant que le dogmatisme est enraciné dans notre manière même de penser.
Paralysie et violence
Culturellement, le dogmatisme engendre stagnation et appauvrissement. Les sociétés régies par des structures rigides répriment souvent l’innovation, punissent la dissidence et s’accrochent à des pratiques dépassées. L’histoire des sciences regorge de découvertes retardées pendant des décennies à cause d’un attachement aveugle aux idées dominantes.
Le sociologue Zygmunt Bauman a analysé comment les dogmes modernes de pureté raciale et sociale ont culminé avec l’Holocauste—et comment des projets présentés comme « rationnels » peuvent devenir des machines d’extermination lorsqu’ils s’appuient sur des certitudes absolues. La persécution des hérétiques pendant l’Inquisition, les purges idéologiques des régimes totalitaires et le déni persistant des preuves scientifiques illustrent la puissance destructrice d’une pensée fermée.
Bulles informationnelles et polarisation
Les technologies numériques ont amplifié les tendances dogmatiques. Les algorithmes nous connectent principalement à des contenus confirmant nos opinions, créant des chambres d’écho où les perspectives divergentes sont rares.
Les nuances, les doutes et les compromis attirent moins l’attention que les affirmations péremptoires et la diabolisation de l’adversaire. Cette dynamique alimente la fragmentation sociale, divisant la société en tribus idéologiques de plus en plus isolées et hostiles.
Le dogmatisme comme mécanisme de pouvoir
Michel Foucault a montré comment les discours dogmatiques sur la sexualité, la folie ou la criminalité ont historiquement servi à contrôler les corps et les esprits. Les prétendues « vérités incontestables » sur les comportements acceptables façonnent la réalité. Des affirmations comme « c’est la nature humaine » ou « c’est ainsi que fonctionne l’économie » présentent des constructions sociales—souvent au service d’intérêts particuliers—comme des évidences.
Le dogmatisme n’est jamais politiquement neutre. Les certitudes absolues avantagent certains groupes, même lorsqu’elles se présentent comme universelles. C’est pourquoi de nombreuses luttes émancipatrices commencent par démanteler ces « évidences » qui légitiment l’ordre établi.
« Le problème du monde, c’est que les idiots sont sûrs d’eux tandis que les intelligents doutent. » —Bertrand Russell
LA QUÊTE ÉTERNELLE DE L’IMMORTALITÉ
Les limites de l’existence ont été une constante dans l’histoire. Cette aspiration est la force motrice qui a poussé les civilisations, inspiré des chefs-d’œuvre et catalysé des découvertes scientifiques.
C’est dans les anciennes civilisations que les premières tentatives de conquérir la mortalité ont vu le jour. En Égypte, la pratique de la momification visait à préserver le corps comme demeure éternelle du ka et du ba. Les pyramides témoignent d’une culture qui a consacré d’immenses ressources à se préparer pour la vie après la mort, convaincue que l’existence devait se prolonger au-delà du seuil physique.
Qin Shi Huang, unificateur de la Chine, envoya des expéditions vers des terres lointaines à la recherche d’herbes et de substances mythiques pouvant lui accorder la vie éternelle. Pourtant, beaucoup de ces empereurs moururent paradoxalement empoisonnés par les mêmes composés de mercure et autres métaux que leurs alchimistes leur assuraient être la clé de l’immortalité. La célèbre armée de terre cuite symbolise une forme alternative de perpétuation : s’il ne pouvait vivre éternellement en chair et en os, du moins sa mémoire et son pouvoir seraient immortalisés dans l’argile.
Les alchimistes européens, arabes et asiatiques consacrèrent des vies entières à déchiffrer les secrets de la matière, convaincus que la compréhension de la nature leur révélerait les clés pour inverser le vieillissement et vaincre la mort. Paracelse, médecin et alchimiste suisse du XVIe siècle, chercha ardemment l’« elixir alkahest », un dissolvant universel qui, selon lui, pourrait purifier le corps humain de toute maladie et détérioration.
Les religions du monde ont offert diverses formes de transcendance : la promesse chrétienne de la vie éternelle après le jugement dernier, la réincarnation dans l’hindouisme et le bouddhisme, ou la permanence dans la mémoire collective à travers les rites ancestraux. Ces constructions spirituelles témoignent de la résistance à accepter la fin définitive de la conscience individuelle.
La littérature a été un véhicule pour explorer cette obsession. L’Étrange Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert Louis Stevenson, Le Mort immortel et Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley, L’Immortel de Jorge Luis Borges, L’Immortalité de Milan Kundera, parmi bien d’autres œuvres.
Le XXe siècle a marqué un changement de paradigme dans la quête de l’immortalité. La science, avec ses avancées en médecine et en biologie, a doublé l’espérance de vie dans de nombreuses sociétés. Des maladies autrefois mortelles sont devenues traitables, voire guérissables. Cette révolution biomédicale a nourri un optimisme scientifique selon lequel la mort pourrait n’être qu’un problème technique à résoudre.
Ray Kurzweil, futurologue et directeur de l’ingénierie chez Google, a popularisé l’idée de la « singularité », un point hypothétique où le progrès technologique s’accélérerait exponentiellement, permettant, entre autres, une extension indéfinie de la vie. Le mouvement transhumaniste, dont Kurzweil est un représentant notable, voit dans la fusion de l’humain et de la technologie l’étape suivante de l’évolution, une transcendance des limites biologiques incluant, bien sûr, la conquête de la mort.
De la prise de cocktails de suppléments à l’auto-administration de thérapies expérimentales, en passant par des modifications plus radicales comme les implants technologiques, ces chercheurs modernes d’immortalité sont prêts à transformer leurs propres corps en laboratoires vivants.
Les entreprises de biotechnologie ont capté cette aspiration millénaire, l’orientant vers des recherches sur le vieillissement. Des sociétés comme Calico, soutenue par Google, investissent des millions dans l’étude des mécanismes cellulaires du vieillissement, espérant les inverser ou au moins les ralentir significativement. La sénolytique, discipline visant à éliminer les cellules vieillissantes de l’organisme, promet non seulement de prolonger la vie, mais aussi d’en améliorer la qualité durant les années gagnées.
Le développement des technologies CRISPR pour l’édition génétique a révolutionné les possibilités d’intervention sur le vieillissement et la dégénérescence cellulaire. Des scientifiques comme David Sinclair à Harvard étudient comment la reprogrammation épigénétique pourrait inverser le vieillissement, restaurant la fonctionnalité des cellules sénescentes. La médecine régénérative, utilisant des cellules souches pour reconstruire tissus et organes endommagés, vise un avenir où les greffes d’organes cultivés en laboratoire pourraient prolonger indéfiniment la durée de vie du corps humain.
Parallèlement, la recherche sur la plasmaphérèse (transfert de plasma sanguin de jeunes vers des personnes âgées) explore comment les composants du sang jeune pourraient revitaliser les tissus vieillissants, dans une approche teintée de mythologie vampirique. La relation entre le microbiote intestinal et la longévité ouvre une autre voie prometteuse : il a été prouvé que la composition de la flore bactérienne influence directement l’espérance de vie et la santé durant la vieillesse.
Des entreprises comme Alcor Life Extension Foundation proposent la cryoconservation de corps ou de cerveaux après la mort légale, dans l’espoir que les futures technologies permettront leur réanimation. C’est un pari sur le long terme, fondé sur la définition de la mort comme la perte irréversible d’information dans le cerveau, et non simplement l’arrêt des fonctions biologiques. Ce concept, digne de la science-fiction, soulève des questions sur la continuité de l’identité : l’individu réanimé serait-il la même personne ou simplement une copie physique avec des souvenirs similaires ?
La vitrification (procédé transformant les tissus en un état vitreux pour éviter les dommages de la cristallisation) a considérablement amélioré les perspectives techniques de la cryogénie, bien que la préservation des structures neuronales contenant la conscience et l’identité reste une inconnue.
Parallèlement à ces efforts matériels, l’immortalité numérique émerge comme une possibilité. Nos traces numériques forment un héritage survivant à notre existence physique. Des projets d’intelligence artificielle visent à créer des « jumeaux numériques » capables de simuler la personnalité, les connaissances et les schémas de pensée de défunts, permettant aux vivants de « converser » avec des versions algorithmiques de proches disparus.
Cet intérêt renouvelé pour vaincre la mort coïncide avec la sécularisation de nombreuses sociétés. Alors que les promesses religieuses de vie éternelle perdent de leur force pour certains, la science et la technologie se présentent comme de nouvelles sources d’espoir transcendantal. Il n’est pas anodin que la Silicon Valley, épicentre mondial de l’innovation technologique, soit aussi un foyer important du mouvement pour l’extension de la vie.
Dans ce contexte, on assiste à l’émergence de ce qu’on pourrait appeler des « religions technologiques ». Le mouvement transhumaniste, avec Nick Bostrom et Max More, a développé sa propre cosmologie, où la singularité technologique remplace l’apocalypse religieux traditionnel, et la transcendance du corps biologique supplante le salut spirituel.
Pourtant, le rêve de l’immortalité soulève des dilemmes éthiques, sociaux et existentiels. Une vie potentiellement infinie serait-elle supportable pour une psyché humaine adaptée à des cycles finis ? Qu’adviendrait-il de concepts comme la famille, l’héritage ou la carrière dans un monde où les générations pourraient se chevaucher indéfiniment ? Comment la créativité et le progrès culturel seraient-ils affectés par la permanence des mêmes esprits pendant des siècles ?
Plus inquiétante encore est l’inégalité que cela engendrerait. Les technologies d’extension de la vie, du moins initialement, ne seraient accessibles qu’à une élite économique, créant une nouvelle stratification sociale : les « immortels » privilégiés face aux masses condamnées au cycle traditionnel de vie et mort. Cette bifurcation de l’espèce pourrait générer des tensions sociales sans précédent.
D’un point de vue politique, comment gouverner des sociétés composées d’individus aux espérances de vie inégales ? Des quotas temporels de pouvoir seraient-ils établis pour éviter la perpétuation d’élites immortelles ? Existerait-il des mécanismes de renouvellement obligatoire pour les positions d’influence ? Des systèmes juridiques spécifiques réguleraient-ils les droits et responsabilités des immortels potentiels, notamment concernant le mariage, les contrats à long terme ou la propriété intellectuelle ? La jurisprudence de l’immortalité reste un champ à développer.
Sur le plan écologique, nos systèmes sociaux, économiques et environnementaux sont conçus autour du renouvellement générationnel. Un scénario d’immortalité massive exigerait de repenser notre relation aux ressources naturelles et à l’espace habitable. L’expansion vers d’autres planètes, proposée par Elon Musk avec ses projets de colonisation martienne, pourrait aussi répondre au besoin induit par l’extension potentielle de la vie humaine. Ainsi, l’élan spatial et la quête d’immortalité pourraient être deux manifestations complémentaires du même désir de transcender les limites naturelles imposées à notre espèce.
Le renouvellement générationnel permet la diversité génétique et l’adaptation à des environnements changeants. Une espèce immortelle pourrait devenir plus vulnérable à long terme, privée de la flexibilité offerte par le remplacement des générations. Cherchons-nous à éliminer précisément ce qui a garanti le succès évolutif de notre espèce ?
L’immortalité est-elle véritablement souhaitable ? Bernard Williams soutenait dans son essai Le Cas Makropoulos qu’une vie éternelle conduirait inévitablement à un ennui insupportable, à mesure que les expériences nouvelles et significatives s’épuiseraient. Selon lui, nos projets et désirs, qui donnent structure et sens à nos vies, finiraient par être satisfaits ou deviendraient insignifiants, nous laissant dans un état d’indifférence existentielle.
Martha Nussbaum avance qu’une vie bonne n’est pas nécessairement une vie sans fin, mais une vie où nous pouvons pleinement développer nos capacités essentiellement humaines. Pour Nussbaum, la finitude est une condition qui donne de la valeur à nos expériences et relations.
Le désir d’immortalité révèle notre capacité à rêver au-delà des limites apparentes de la réalité, notre créativité pour imaginer des solutions, mais aussi notre difficulté à accepter les conditions fondamentales de l’existence et notre tendance à chercher des exceptions personnelles aux lois naturelles régissant tous les êtres vivants.
Peut-être la quête de l’immortalité n’est-elle pas tant une fuite devant la mort qu’une recherche de sens. Les monuments pharaoniques, les élixirs alchimiques, les œuvres littéraires immortelles et les avancées biotechnologiques contemporaines partagent une même impulsion : laisser une trace, transcender, affirmer que notre existence a un mérite à perdurer.
La fascination pour l’effondrement.
La fin ne s’annonce plus par des trompettes apocalyptiques, mais à travers des rapports scientifiques, des courbes de températures mondiales en hausse, des cartes de déforestation et des matrices de crises interconnectées. L’effondrement a dépassé son statut de menace future pour s’installer comme climat émotionnel du présent, comme perspective à travers laquelle nous interprétons les événements actuels et esquissons des possibilités futures.

Le récit de l’effondrement semble nous dire que nous n’assisterons pas à de grandes transformations révolutionnaires ni à un avenir améliorant les conditions actuelles. Seulement la lente désagrégation des systèmes qui soutiennent la civilisation industrielle – et avec elle, une étrange attraction pour cette image terminale, comme si la contempler produisait un effet libérateur.
Pourquoi cette fascination pour la fin ? Quelles sont les implications de considérer l’effondrement comme l’horizon le plus plausible, voire le plus désirable, plutôt que la transformation sociale ?
L’imagination utopique apparaît affaiblie. La collapsologie se présente comme un substitut à la pensée utopique. Au lieu de projeter des sociétés alternatives ou des mondes possibles, nous nous consacrons à calculer des variables de désintégration, des points de non-retour, des seuils écologiques irréversibles.
Si le XXe siècle a été marqué par de grands récits émancipateurs, le XXIe siècle semble se définir par des discours d’épuisement, de limite et de finitude.
Les travaux de la collapsologie proposent une pédagogie pour développer une résilience émotionnelle face à ce qu’ils considèrent comme inévitable. Le sujet contemporain ne se prépare pas à transformer radicalement les conditions matérielles de son existence, mais à survivre à leur détérioration.
La collapsologie a évolué en tant que courant de pensée. Les premiers textes mettaient l’accent sur les preuves scientifiques d’un effondrement imminent : limites physiques de la croissance, crise énergétique, dérèglement climatique, extinction massive d’espèces. Par la suite, ses théorisations ont intégré des dimensions psychologiques, communautaires et existentielles.
La contemplation du grand effondrement procure un certain soulagement existentiel. Dans un contexte caractérisé par l’accélération permanente, la fragmentation de l’expérience, la sur-exigence productive et la saturation informationnelle, l’image d’un effondrement total offre une sorte de purification par le chaos.
La fin imaginée agit comme une force simplificatrice. Elle promet de réduire une réalité écrasante à une situation élémentaire, primaire. Cette fantaisie d’un retour à l’essentiel exerce un puissant attrait dans des sociétés hypercomplexes où l’individu éprouve constamment son impuissance face à des systèmes abstraits et incontrôlables.
L’attente de l’effondrement intègre une dimension de justice cosmique. Le système qui a exploité les ressources naturelles, les populations vulnérables et les subjectivités pendant des siècles semble « mériter » sa fin. Si la transformation politique organisée paraît inviable, l’effondrement apparaît comme un juge impartial qui prononcera son verdict sous le poids des contradictions systémiques accumulées. Cet espoir inversé constitue un refuge singulier pour la pensée critique lorsqu’elle perçoit d’autres voies de changement social comme fermées.
Cependant, la fascination pour l’effondrement peut facilement se muer en une forme de passivité déguisée en lucidité analytique. La contemplation de scénarios apocalyptiques peut engendrer une paralysie similaire à celle qu’induisait autrefois l’idéologie du progrès indéfini. Le vrai danger réside dans l’effondrement anticipé de la volonté collective de transformation.
La certitude du désastre peut fonctionner comme une prophétie auto-réalisatrice, précisément parce qu’elle élimine l’incertitude nécessaire à l’action. Si nous sommes absolument sûrs que tout s’effondrera, pourquoi nous efforcer de l’éviter ?
Contrairement aux catastrophes soudaines imaginées par les anciennes traditions apocalyptiques, l’effondrement collapsologique se caractérise par sa nature graduelle, diffuse, souvent imperceptible dans l’expérience quotidienne immédiate. Ce qui était autrefois conçu comme un événement spectaculaire est désormais perçu comme un processus cumulatif. Un « apocalypse sans apocalypse ».
Les indicateurs d’épuisement systémique prolifèrent : pénuries d’eau dans des régions toujours plus vastes, augmentation statistique des troubles mentaux, dégradation progressive des sols agricoles, fatigue institutionnelle dans les démocraties consolidées, polarisation croissante des communautés politiques, atomisation sociale… Aucun de ces phénomènes ne constitue une rupture définitive, mais leur ensemble dessine un paysage de détérioration persistante. L’effondrement actuel ressemble moins à l’explosion d’une bombe qu’à la progression silencieuse d’une maladie chronique.
Nous habitons un monde en train de s’effondrer sans en faire l’expérience à chaque instant. Nous nous adaptons cognitivement à la dégradation, normalisant ce qui aurait paru alarmant il y a quelques décennies. L’effondrement configure une atmosphère constante plutôt qu’un événement singulier. Comme un « hyperobjet », il est trop distribué dans l’espace et le temps pour être saisi dans sa totalité par notre expérience immédiate.
Ainsi, la conscience habite un temps suspendu, un présent prolongé qui ne s’effondre jamais complètement mais n’offre pas non plus de possibilités claires de renouveau. Cette suspension temporelle corrode les grands récits modernes fondés sur l’idée de progrès, sans proposer en échange une nouvelle organisation du temps historique.
La collapsologie a connu un processus de marchandisation culturelle. La fin du monde est devenue un produit médiatique de consommation de masse. Documentaires apocalyptiques, littérature dystopique, jeux vidéo situés dans des scénarios post-effondrement, chaînes YouTube spécialisées dans la survie, comptes dédiés sur les réseaux sociaux recensant méticuleusement chaque nouveau symptôme catastrophique, séries, films… L’économie de l’attention a intégré la peur civilisationnelle comme moteur rentable.
Les algorithmes numériques, conçus pour maximiser le temps d’exposition aux contenus, amplifient systématiquement les scénarios les plus inquiétants, offrant un flux constant d’images catastrophiques. Cette circulation massive de représentations apocalyptiques modifie substantiellement notre rapport à l’idée même d’effondrement.
En transformant l’effondrement en objet de consommation culturelle, nous le neutralisons comme force mobilisatrice. Nous le convertissons en spectacle, en expérience vicariante, en divertissement. Alors que nous débattons avec passion pour savoir si tel phénomène météorologique extrême constitue une preuve définitive de l’effondrement climatique, nous continuons à participer aux pratiques quotidiennes qui l’accélèrent. La spectacularisation de la fin crée une distance qui nous immunise contre son urgence pratique.
Ce phénomène génère une forme de schizophrénie cognitive : nous connaissons la gravité de multiples crises convergentes, mais cette connaissance se traduit rarement par des transformations significatives de nos modes de vie. La représentation médiatique de l’effondrement agit comme une valve d’échappement permettant de soulager la tension cognitive sans modifier les conditions matérielles qui la génèrent.
Nous vivons à « l’ère de l’hypocrisie » : nous en savons trop pour continuer à agir comme nous le faisons, mais nous persistons tout en diffusant obsessionnellement des connaissances sur l’insoutenabilité de nos pratiques.
Il ne semble pas viable de nier la gravité objective de multiples crises convergentes, pas plus qu’il n’est acceptable de se résigner à un fatalisme paralysant. La collapsologie a raison sur de nombreux aspects diagnostiques : le monde façonné par la modernité industrielle traverse une crise multidimensionnelle. Pourtant, la réponse appropriée ne peut se limiter à la contemplation mélancolique de ruines anticipées ni au plaisir morbide de la catastrophe.
La réflexion sur l’effondrement nécessite de considérer la multiplicité des temporalités à l’œuvre simultanément. Le temps géologique de la planète, le temps biologique de l’évolution, le temps accéléré des marchés financiers, le temps politique des démocraties électorales, le temps intime de l’expérience subjective… Chacun de ces registres temporels vit l’effondrement différemment.
Ce que nous appelons « effondrement » constitue un complexe de processus asymétriques. Tandis que certaines espèces disparaissent à jamais, d’autres organismes prolifèrent dans des niches écologiques altérées. Tandis que certaines institutions sociales se désintègrent, des formes inédites d’organisation communautaire émergent. Tandis que certaines structures technologiques échouent, d’autres acquièrent une centralité autrefois impensable.
Cette hétérogénéité temporelle est cruciale pour dépasser une conception monolithique de l’effondrement comme événement unique et homogène. Ce que nous vivons correspond davantage à des « zones de ruine » : des espaces où la vie continue sous des conditions altérées, où la destruction coexiste avec la persistance, où la perte irréversible n’exclut pas l’émergence de possibilités imprévues.
Comprendre cette multiplicité temporelle permet d’éviter deux simplifications opposées : celle qui réduit l’effondrement à une catastrophe instantanée et celle qui le nie entièrement en raison de son caractère graduel. Nous avons besoin de « mots pour penser ce qui nous arrive », des mots capables de saisir à la fois la gravité de notre situation et les possibilités encore ouvertes en son sein.
Chaque époque rêve la suivante tout en sombrant.
La collapsologie remplit une fonction importante lorsqu’elle démonte les illusions dangereuses sur la durabilité du modèle civilisationnel actuel. Mais sa plus grande contribution pourrait être de nous aider à imaginer quel genre de vie vaut la peine d’être vécu lorsque les promesses de la modernité industrielle ont perdu toute crédibilité. Ce que nous pouvons apprendre.
LA NOUVELLE MASCULINITÉ
Ces dernières décennies, nous avons assisté à une transformation dans la manière de comprendre et de vivre la masculinité. Ce qui semblait autrefois un concept incontestable est aujourd’hui un terrain de remise en question et de réinvention. Cette métamorphose correspond aux changements sociaux, économiques et culturels qui ont ébranlé les fondements sur lesquels se construisaient les identités de genre traditionnelles.
Pendant des siècles, une notion dominante a associé le masculin à des caractéristiques telles que la force physique, l’autorité, la provision économique, le contrôle émotionnel et une certaine distance par rapport aux tâches de soin. Dès leur plus jeune âge, les garçons étaient éduqués pour endosser le rôle de pourvoyeurs, de leaders, de protecteurs, voire de combattants. Cette vision s’est consolidée grâce à la force de la coutume, des mythes, des religions, des systèmes économiques et des institutions éducatives.
D’où vient cette coïncidence interculturelle ? Certains biologistes évolutionnistes pointent des différences hormonales et physiques qui prédisposent (sans toutefois les déterminer) certaines tendances comportementales. Les pressions sélectives ancestrales auraient pu favoriser certains traits dans des environnements de pénurie et de danger, tandis que d’autres estiment que ces similitudes relèvent plutôt de mécanismes de domination similaires reproduits dans des contextes divers.
Malgré cela, cette apparente universalité a été remise en question par des recherches montrant que les façons d’être un homme varient considérablement selon le contexte historique et culturel. Bien qu’il existe des schémas communs, comme l’association entre masculinité et compétition, ou entre masculinité et maîtrise de soi, certaines communautés intègrent des tâches d’éducation, de coopération et d’expression émotionnelle dans l’identité masculine. Cela prouve que la masculinité, comme toute autre identité de genre, est malléable et contingente.
Il est vrai que le modèle traditionnel a fonctionné pendant des millénaires, mais il a commencé à se fissurer au XXe siècle. Les mouvements féministes ont contesté les privilèges masculins et démonté la naturalité de rôles présentés comme biologiquement inévitables.
Les guerres mondiales ont obligé à réorganiser le travail et la vie domestique. L’industrialisation, puis l’économie de services, ont transformé la valeur sociale de la force physique. La démocratie a érodé les hiérarchies rigides. La révolution sexuelle a dissocié sexualité et reproduction. L’accès des femmes à des espaces historiquement masculins et les luttes pour l’élargissement des droits sexuels et reproductifs ont forcé à reconsidérer ce que l’on attend désormais des hommes.
Lorsque les marqueurs traditionnels de réussite et d’accomplissement s’estompent, beaucoup d’hommes vivent un état liminal : ils n’appartiennent plus à l’ancien ordre, mais n’ont pas encore trouvé leur place dans le nouveau.
Alors que les femmes célèbrent (à juste titre) leur libération des rôles prédéterminés comme une expansion des possibilités, de nombreux hommes vivent cette même libération comme un vide désorientant. D’un côté, ils se libèrent d’une contrainte imposée ; de l’autre, ils perdent un sens naturalisé.
Cette perte de repères génère une anxiété silencieuse qui, faute de canaux d’expression socialement acceptables, peut se manifester par des comportements destructeurs ou un repli vers la nostalgie. Il n’est pas anodin que le taux de suicide masculin dans les sociétés industrialisées soit trois à quatre fois plus élevé que chez les femmes, tandis que l’abus de substances et les troubles comportementaux présentent une prévalence nettement masculine.
Les hommes sont aujourd’hui plus libres, mais moins équipés émotionnellement pour gérer cette liberté, prisonniers de l’épuisement que provoque la construction constante de leur identité sans modèles clairs ou socialement validés.
La nostalgie des certitudes perdues alimente des mouvements réactionnaires promettant de restaurer un ordre mythique où « les hommes étaient des hommes ». Ces groupes prospèrent souvent dans des contextes de précarité, où la promesse d’une supériorité de genre compense d’autres carences. Beaucoup d’hommes ont le sentiment d’avoir perdu une place qui leur offrait autrefois des certitudes, un statut et une reconnaissance. Dans ce vide, certains succombent à des discours promettant de rétablir un ordre ancien, où les hiérarchies étaient claires et les règles incontestées.
Ce besoin d’appartenance explique aussi l’essor de communautés masculines traditionnelles et virtuelles (des clubs sportifs aux forums en ligne), qui servent d’espaces où l’identité masculine peut s’exercer sans être constamment remise en question. Le problème survient lorsque ces refuges deviennent des enclaves de ressentiment plutôt que des lieux de transformation positive.
L’asymétrie des territoires exclusifs
La différence de traitement des espaces réservés à un genre révèle les contradictions actuelles. Alors que des initiatives comme The Wing ou Hera Hub sont célébrées comme des territoires nécessaires à l’émancipation féminine, des équivalents masculins comme The Bohemian Grove font face à des critiques sévères, perçus comme des bastions de privilèges.
Les entreprises exclusivement féminines sont saluées comme innovantes, tandis que toute initiative similaire masculine serait immédiatement qualifiée de discriminatoire. Ce double standard, bien que compréhensible dans une logique compensatoire, nourrit un ressentiment chez certains hommes qui ne se perçoivent ni comme privilégiés ni comme oppresseurs, en particulier parmi les jeunes des classes populaires confrontés à leurs propres formes de marginalisation économique et sociale.
Cette asymétrie n’est pas arbitraire et s’appuie sur des fondements historiques. Reste à savoir si la justice transformative nécessite ces disparités temporaires ou si elle renforce les catégories qu’elle prétend dépasser. Après des décennies d’observation, on commence à se demander si nous ne créons pas un nouveau lot de stéréotypes restrictifs, cette fois appliqués aux hommes.
Inégalités institutionnelles et vulnérabilités invisibilisées
Sur le plan institutionnel, des programmes comme le Women’s Entrepreneurship Fund au Canada ou les bourses réservées aux femmes en ingénierie représentent des efforts légitimes pour corriger des déséquilibres historiques. Les données montrant que les femmes ne reçoivent que 2,3 % du capital-risque mondial ou n’occupent que 28 % des postes de direction justifient pleinement ces interventions.
Cependant, ces efforts coexistent avec des réalités moins médiatisées : les hommes représentent 93 % des décès professionnels, ont des taux de décrochage scolaire plus élevés et subissent des peines judiciaires 63 % plus sévères que les femmes pour les mêmes crimes. La crise éducative masculine grandissante, où les femmes surpassent largement les hommes en taux de diplômés universitaires dans la plupart des pays occidentaux, génère rarement des programmes compensatoires spécifiques.
Une approche réellement équitable nécessiterait de reconnaître les vulnérabilités spécifiques des deux côtés du spectre du genre. La justice de genre ne peut pas être un jeu à somme nulle où les progrès d’un groupe impliquent nécessairement des reculs pour l’autre.
Le corps masculin et la santé mentale
Un aspect souvent ignoré est la relation des hommes à leur corporalité. La pression pour incarner des idéaux physiques inatteignables a explosé, comme en témoigne la hausse des troubles dysmorphiques et alimentaires chez les jeunes hommes. L’image du corps masculin parfait, omniprésente dans les médias et les réseaux sociaux, crée une nouvelle forme d’aliénation.
Éduqués à voir leur corps comme un instrument de performance, beaucoup d’hommes perdent le lien avec leur expérience corporelle vécue. Cette déconnexion affecte leur bien-être physique et leur capacité à établir des relations intimes significatives.
La santé mentale masculine est également un angle mort. La répression émotionnelle, l’isolement, la difficulté à demander de l’aide ou la peur de paraître faible découlent d’une éducation affective conditionnée par le modèle traditionnel. Cela entraîne une chronicisation de la souffrance psychique, l’abus de substances ou la violence auto-infligée. Sans cette alphabétisation affective, toute transformation sociale restera incomplète.
La paternité comme espace de réinvention
La paternité émerge aujourd’hui comme l’un des terrains les plus prometteurs pour réinventer la masculinité. Historiquement cantonnée à la provision économique et à l’autorité normative, elle se redéfinit dans de nouvelles configurations familiales, permettant des formes plus participatives, affectives et engagées dans le soin quotidien.
Cette paternité impliquée a des bénéfices tangibles : des enfants avec une meilleure estime de soi et des compétences sociales accrues, mais aussi des hommes plus épanouis, avec des liens sociaux plus riches. L’expérience du soin paternel profite aux enfants et constitue une opportunité de transformation pour les hommes eux-mêmes.
Pourtant, les structures professionnelles, les attentes culturelles et les politiques familiales continuent d’entraver cette évolution. La durée asymétrique des congés parentaux (bien plus courts pour les pères) ou l’écart salarial persistant, qui rend « économiquement rationnel » que la mère réduise son temps de travail, montrent comment les structures sociales renforcent les rôles traditionnels, même quand hommes et femmes souhaitent les dépasser.
Conclusion : au-delà du binaire
Il ne s’agit pas d’une guerre entre hommes et femmes, mais d’un effort collectif pour redéfinir l’humain au-delà des catégories binaires restrictives. L’enjeu est de reconnaître la légitimité de multiples façons d’être un homme, y compris celles qui ne correspondent pas à la norme.
Sources consultées
-
Gilmore, David D. Hacerse hombre: concepciones culturales de la hombría.
-
Bribiescas, Richard. How Men Age: What Evolution Reveals about Male Health and Mortality.
-
Kimmel, Michael. Guyland: The Perilous World Where Boys Become Men.
-
Perel, Esther. Interviews et conférences sur le genre et la sexualité.
-
Bonino, Luis. Textes sur les micromachismes et la psychologie masculine.
-
Segato, Rita. Essais sur la violence de genre et le patriarcat.
-
Fraser, Nancy. Fortunes du féminisme.
-
Connell, Raewyn. Masculinities.
-
Hooks, Bell. The Will to Change: Men, Masculinity, and Love.
-
Preciado, Paul B. Essais sur le genre et la biopolitique.
(Traduction adaptée pour respecter le style et les nuances du texte original.)